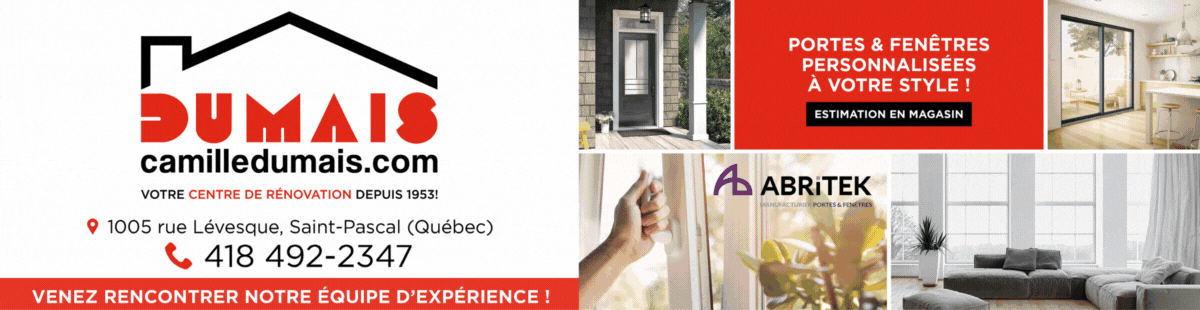L’Union des producteurs agricoles (UPA) aime bien, dans ses interventions et ses publicités télévisées, parler de notre territoire agricole comme de notre « garde-manger » qu’il faut protéger. C’est dans l’air du temps : l’autonomie, l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires. Concrètement, dans le discours de l’UPA, cela veut dire interdire en zone verte tout développement urbain, toute installation industrielle et toute activité qui n’est pas de la « vraie » agriculture productive. En d’autres mots, la zone verte, c’est réservé à l’agriculture d’affaires.
Ce discours, bien que rigide, centralisateur et laissant peu de place pour tenir compte des situations locales particulières et des instances démocratiques locales et régionales, serait plus convaincant si l’utilisation actuelle de la zone agricole ne servait pas largement à nourrir les pays étrangers plutôt que nous, les Québécois, et du même coup, à faire faire de l’argent à une poignée de gros industriels et exportateurs plutôt qu’aux vrais fermiers qui nourrissent leur communauté.
La part de notre nourriture produite chez nous est aujourd’hui d’environ 35 % (50 % si on y inclut des aliments produits ailleurs, mais « transformés » au Québec). Cette part québécoise vient surtout des productions protégées par la gestion de l’offre, soit les produits laitiers et les produits de la volaille qui constituent à eux seuls 37 % de la production agricole québécoise. À cela, il faut ajouter le porc.
Mais nous sommes largement déficitaires dans le domaine des poissons, des légumes (de serre surtout), des fruits, des farines, des huiles et surtout des produits transformés en général. Les espaces cultivés, selon les méthodes biologiques ne représentent que 5 % du total, contrairement à plusieurs pays européens où ils atteignent 20 à 30 %. Les fermiers de famille (30 000 paniers cette année) et les marchés publics (officiellement près de 150 cette année) sont très populaires, mais la part des aliments issus de l’agriculture de proximité dépasse à peine 1 ou 2 % du total. On en parle beaucoup plus qu’on en fait et qu’on en mange ! En dehors des productions contingentées (lait et volaille), l’essentiel de notre production agricole demeure le fourrage (pour les ruminants), les grandes monocultures intensives de céréales (plus de 60 % de nos terres) destinées aux animaux… et aux autos (éthanol – maïs + 5 %). Les déserts de maïs transgénique, ce n’est pas vraiment pour nous.
Ce qu’il faut savoir surtout, et qu’on sait peu, c’est que depuis le début des ententes de libre-échange au début des années 1990, notre production agricole s’est orientée massivement vers l’exportation. 70 % des porcs que nous produisons, soit près de six millions sur huit et les meilleurs, sont exportés aux États-Unis, en Chine et au Japon. Nous exportons aussi de plus en plus de céréales (soya, blé, canola, maïs, etc.), biologiques notamment, même du foin pour les chevaux des Arabes ou les troupeaux chinois. La croissance des exportations de sirop d’érable est telle qu’elle est en train de transformer nos cabanes à sucre en usines informatisées de bouillage et nos érablières en chantiers technologiques d’extraction. Dans la politique agricole en place, on vise à augmenter la valeur de notre « production d’autosuffisance » de 10 MM $ — d’où, par exemple, une récente subvention de 23 M$ et un prêt de 30 M$ aux Serres Demers —, mais également la valeur de nos exportations de 6 MM $ : c’est un peu contradictoire tout cela, il me semble.
On nous répond que les agriculteurs doivent vivre et que l’exportation fait rentrer de l’argent. Mais qui en profite ? La concurrence du libre-échange a forcé la concentration et la spécialisation des fermes. La plupart de ces productions d’exportation sont dominées par de gros intégrateurs, la Coop fédérée en tête, qui paient les agriculteurs à forfait : ce ne sont donc pas les agriculteurs qui empochent, surtout pas ceux des régions éloignées. Entre-temps, la majorité de nos meilleures terres sont surexploitées pour exporter plutôt que pour nous nourrir et les produits étrangers souvent toxiques qui entrent à pleines frontières font concurrence à nos produits locaux de bonne qualité.
L’autosuffisance alimentaire étant à la mode, les gros joueurs s’en servent pour justifier — ou camoufler — un peu n’importe quoi. La réalité brutale, c’est que notre taux d’autosuffisance alimentaire réelle n’est guère plus que de 30 % alors qu’il atteignait près de 80 % quand le ministre Jean Garon a quitté le ministère de l’Agriculture dans les années 1980. Vive le libre-échange et l’agriculture d’exportation !